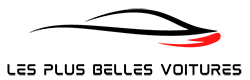Les constructeurs automobiles condamnés à plus de 550 M€ pour un cartel sur le recyclage
L’UE et le Royaume-Uni infligent 550 M€ d’amendes à des constructeurs automobiles pour un cartel sur le recyclage des véhicules, limitant la concurrence et l’information des consommateurs.
Les régulateurs européens et britanniques ont sanctionné des constructeurs automobiles et des associations professionnelles pour un total de plus de 550 millions d’euros en raison d’un cartel sur le recyclage des véhicules. La Commission européenne a imposé 458 millions d’euros d’amendes à 15 grands fabricants, dont Volkswagen, Renault, BMW, et Ford, ainsi qu’à l’ACEA (Association des constructeurs automobiles européens). Au Royaume-Uni, la CMA (Competition and Markets Authority) a infligé 77,7 millions de livres sterling (environ 92,7 M€) à 10 constructeurs et deux organismes, dont le SMMT. Ces entreprises ont coordonné leurs actions entre 2002 et 2017, refusant de payer les démanteleurs pour le recyclage des véhicules hors d’usage (VHU) et limitant la concurrence sur la communication de la recyclabilité. Mercedes-Benz, impliqué, a évité les sanctions en dénonçant le cartel. Ces pratiques ont nui à la transparence pour les consommateurs et aux objectifs environnementaux.

L’ampleur des sanctions financières et les acteurs impliqués
La Commission européenne a infligé une amende totale de 458 millions d’euros à 15 constructeurs automobiles majeurs et à l’ACEA. Parmi les entreprises sanctionnées figurent Volkswagen (128 M€, la plus lourde peine), Renault/Nissan (81,5 M€), Stellantis (74,9 M€), Ford (41,5 M€), et BMW (25 M€). D’autres acteurs comme Toyota (23,9 M€), Hyundai/Kia (12 M€), et Volvo Cars (9 M€) ont également été touchés. Au Royaume-Uni, la CMA a imposé 77,7 millions de livres sterling (92,7 M€ au taux de change d’avril 2025) à 10 constructeurs, dont Ford (18,5 M£, soit 22 M€) et Volkswagen (14,8 M£, soit 17,6 M€), ainsi qu’à l’ACEA et au SMMT. Ces chiffres reflètent la gravité et la durée de l’entente, qui s’est étendue sur 15 ans, de mai 2002 à septembre 2017.
Ces sanctions découlent d’une coordination illégale visant à limiter les coûts et la concurrence. Par exemple, Volkswagen, leader mondial avec 10,8 millions de véhicules vendus en 2023 (source : Statista), a utilisé sa position pour influencer les pratiques du secteur. L’implication de l’ACEA, qui regroupe les principaux constructeurs européens, et du SMMT, représentant l’industrie britannique, montre une collusion institutionnalisée. Mercedes-Benz, bien que participant, a obtenu une immunité totale en alertant les autorités dès 2019, évitant ainsi une amende estimée à 35 M€ en Europe. Cette stratégie de coopération a permis une réduction des risques financiers pour l’entreprise, qui produit environ 2 millions de véhicules par an.
Les montants des amendes varient selon la taille des entreprises et leur degré d’implication. La Commission européenne a appliqué ses lignes directrices de 2006 sur les amendes, tenant compte du volume de véhicules concernés (par exemple, 15 millions de VHU sont générés annuellement en Europe selon l’Eurostat 2023) et de la durée de l’infraction. Ces sanctions financières, bien que lourdes, représentent une fraction des revenus annuels des constructeurs : Volkswagen a généré 322,3 milliards d’euros en 2023, soit une amende équivalant à 0,04 % de son chiffre d’affaires.
Les pratiques illégales du cartel sur le recyclage
Entre 2002 et 2017, les constructeurs ont coordonné leurs actions pour éviter de payer les démanteleurs automobiles pour le traitement des véhicules hors d’usage. Selon la directive européenne 2000/53/CE, les fabricants doivent garantir une prise en charge gratuite des VHU par les propriétaires, souvent via des paiements aux démanteleurs. Or, les entreprises ont adopté une stratégie dite « Zero-Treatment-Cost », estimant que le recyclage était suffisamment rentable pour les démanteleurs (métaux récupérés valant environ 200-300 € par tonne, selon les prix 2025). Cette entente a éliminé toute négociation sur les coûts, fixés à 0 €, privant les démanteleurs de revenus supplémentaires.
Par ailleurs, les constructeurs ont convenu de ne pas concurrencer sur la recyclabilité de leurs véhicules. La CMA a qualifié cette pratique de « gentleman’s agreement », formalisé dans l’ELV Charta. Par exemple, alors que certains modèles atteignent une recyclabilité de 95 % (poids des matériaux réutilisables), les entreprises ont limité leurs publicités à un seuil légal minimum de 85 %, masquant leurs performances réelles. Cette entente a été facilitée par l’ACEA, qui organisait des réunions et intervenait en cas de non-respect, et par le SMMT, qui réglait des différends au Royaume-Uni.
Un cas concret : Toyota, qui recycle environ 90 % de ses véhicules (données internes 2024), n’a pas communiqué cette donnée aux consommateurs, suivant l’accord. Cette opacité a empêché les clients de comparer les performances environnementales, un critère clé alors que 60 % des acheteurs européens privilégient la durabilité (sondage Deloitte 2024). Les constructeurs ont aussi caché l’utilisation de matériaux recyclés dans les nouveaux véhicules, sauf Renault, qui a demandé une exemption partielle. Ces pratiques ont duré 15 ans, affectant des millions de véhicules : en 2017, l’UE comptait 6,9 millions de VHU traités (Eurostat).
Conséquences sur les consommateurs et l’environnement
Ces pratiques ont eu un impact direct sur les consommateurs. En limitant l’information sur la recyclabilité, les constructeurs ont réduit la capacité des acheteurs à faire des choix éclairés. Par exemple, un client choisissant entre une BMW Série 3 (recyclable à 92 %) et une Ford Focus (88 %) n’avait accès qu’à des données partielles, faussant la concurrence. Cette opacité a freiné la demande pour des véhicules plus durables, alors que le marché européen des voitures vertes a crû de 25 % entre 2020 et 2024 (ACEA). Les amendes, bien que significatives, ne compensent pas cette perte de transparence, estimée à des milliards d’euros en valeur marchande potentielle.
Sur le plan environnemental, le cartel a entravé les objectifs de l’économie circulaire de l’UE, qui vise un taux de recyclage de 95 % pour les VHU d’ici 2030. En refusant de payer les démanteleurs, les constructeurs ont réduit leurs incitations à investir dans des technologies avancées, comme le tri des plastiques (seulement 10 % recyclés aujourd’hui contre 85 % pour les métaux, selon l’Ademe). Cela a maintenu un système sous-optimal : en 2023, 1,5 million de tonnes de déchets automobiles n’ont pas été valorisées en Europe (Eurostat). Teresa Ribera, de la Commission européenne, a souligné que ces pratiques contredisent les ambitions de décarbonation, alors que l’industrie automobile représente 7 % des émissions de CO2 de l’UE (EEA 2024).
Les démanteleurs, souvent des PME, ont aussi souffert. Avec un chiffre d’affaires moyen de 500 000 € par an (Fédération française des recycleurs), l’absence de paiements a limité leur capacité à moderniser leurs installations. Cela a créé un cercle vicieux : moins d’innovation, moins de recyclage efficace, et un impact environnemental accru.

Réactions et implications pour l’industrie automobile
Les entreprises ont reconnu leur faute et coopéré avec les autorités. Mercedes-Benz a évité des sanctions en dénonçant le cartel dès 2019, une décision stratégique protégeant ses 13,6 milliards d’euros de bénéfices annuels (2023). Stellantis, Mitsubishi, et le SMMT ont obtenu des réductions d’amendes (jusqu’à 45 %) pour leur collaboration. L’ACEA a admis l’infraction mais a minimisé son impact, arguant qu’elle n’a pas nui aux consommateurs ni à l’innovation. Pourtant, les chiffres contredisent cette affirmation : la recyclabilité moyenne des véhicules est passée de 85 % en 2002 à 89 % en 2017, une progression lente malgré les avancées technologiques.
Ces sanctions pourraient transformer l’industrie. Les constructeurs risquent désormais des contrôles accrus, notamment sur leurs déclarations environnementales, alors que le Green Deal européen impose des normes strictes. Les amendes, bien que lourdes (équivalant à 0,1 % du chiffre d’affaires global des 15 constructeurs, soit 550 M€ sur 500 Md€ en 2023), pourraient inciter à plus de transparence. Cependant, elles soulignent une faiblesse : les régulateurs dépendent des dénonciations internes, comme celle de Mercedes-Benz, pour détecter ces cartels. Sans réforme, d’autres ententes pourraient perdurer, surtout dans un secteur sous pression avec l’électrification (coût moyen d’une batterie : 10 000 €, soit 40 % du prix d’un véhicule électrique).
LES PLUS BELLES VOITURES, votre magazine voiture en toute indépendance.