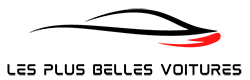Comment l’Europe a donné le bâton à la Chine pour se faire battre
L’Europe tente de combler son retard technologique face à la Chine dans le secteur des véhicules électriques, en misant sur des partenariats stratégiques et des politiques industrielles ciblées.
Depuis les années 1980, l’Europe, notamment l’Allemagne, a joué un rôle clé dans le développement de l’industrie automobile chinoise. Aujourd’hui, la situation s’inverse : les constructeurs européens cherchent à collaborer avec des entreprises chinoises pour accéder à des technologies avancées dans les domaines des logiciels, des batteries et des systèmes de conduite autonome. Des partenariats stratégiques, tels que celui entre Volkswagen et XPeng, illustrent cette tendance. Parallèlement, l’Union européenne met en place des politiques pour encourager les transferts de technologie et renforcer la compétitivité de son industrie automobile face à la montée en puissance de la Chine.
L’évolution des relations sino-européennes dans l’industrie automobile
Au cours des dernières décennies, l’Europe a été un partenaire clé dans le développement de l’industrie automobile chinoise. Des entreprises comme Volkswagen ont établi des coentreprises en Chine dès les années 1980, contribuant à la montée en compétence des constructeurs locaux. Aujourd’hui, la situation s’inverse : les constructeurs européens cherchent à collaborer avec des entreprises chinoises pour accéder à des technologies avancées dans les domaines des logiciels, des batteries et des systèmes de conduite autonome.
Cette évolution reflète un changement de paradigme dans les relations industrielles entre l’Europe et la Chine. Alors que l’Europe a longtemps été perçue comme un leader technologique, elle reconnaît désormais la nécessité de s’associer à des partenaires chinois pour rester compétitive dans le secteur des véhicules électriques.

Les partenariats stratégiques entre constructeurs européens et chinois
Face à la montée en puissance des constructeurs chinois, les entreprises européennes multiplient les partenariats stratégiques pour accéder à des technologies de pointe. Volkswagen, par exemple, a investi environ 700 millions de dollars pour acquérir une participation de 4,99 % dans XPeng, avec pour objectif de développer conjointement deux modèles de véhicules électriques destinés au marché chinois.
D’autres constructeurs européens suivent cette voie : Mercedes-Benz collabore avec Hesai pour des systèmes de détection laser, Stellantis s’associe à Leapmotor, et BMW travaille avec Huawei. Ces alliances visent à combler le retard technologique de l’Europe dans des domaines clés tels que les logiciels embarqués, les batteries et les systèmes de conduite autonome.
Ces partenariats sont également motivés par la nécessité de répondre aux attentes des consommateurs, de plus en plus attirés par les véhicules offrant des fonctionnalités avancées en matière de connectivité et d’assistance à la conduite.
Les politiques industrielles de l’Union européenne face à la concurrence chinoise
Consciente de son retard technologique, l’Union européenne met en place des politiques industrielles pour renforcer la compétitivité de son secteur automobile. En mars 2025, la Commission européenne a présenté un plan d’action pour l’industrie automobile, visant à encourager les transferts de technologie et à favoriser les coentreprises entre entreprises européennes et chinoises.
Ce plan prévoit notamment que les entreprises chinoises souhaitant accéder au marché européen devront partager certaines de leurs technologies ou établir des partenariats avec des entreprises locales. L’objectif est de créer un environnement favorable à l’innovation et à la compétitivité, tout en protégeant les intérêts stratégiques de l’Europe.
Par ailleurs, l’Union européenne envisage de remplacer les droits de douane imposés aux véhicules électriques chinois par des accords sur des prix minimaux, afin de garantir une concurrence équitable tout en facilitant les échanges commerciaux.
Les implications économiques et géopolitiques de la coopération sino-européenne
La coopération croissante entre l’Europe et la Chine dans le secteur des véhicules électriques a des implications économiques et géopolitiques majeures. Sur le plan économique, elle permet aux constructeurs européens de rester compétitifs face à des entreprises chinoises qui bénéficient d’un soutien massif de leur gouvernement. Entre 2009 et 2023, la Chine a investi environ 231 milliards de dollars dans son industrie des véhicules électriques, notamment sous forme de subventions et d’incitations fiscales.
Sur le plan géopolitique, cette coopération soulève des questions sur la souveraineté technologique de l’Europe et sur sa capacité à préserver ses intérêts stratégiques face à une Chine de plus en plus influente. Elle met également en lumière les tensions commerciales entre les grandes puissances, notamment entre la Chine et les États-Unis, et leur impact sur les relations économiques internationales.
Les défis et opportunités pour l’industrie automobile européenne
L’industrie automobile européenne fait face à plusieurs défis majeurs : transition vers les véhicules électriques, concurrence accrue des constructeurs chinois, pression réglementaire pour réduire les émissions de CO₂, et coûts énergétiques élevés. Cependant, ces défis s’accompagnent également d’opportunités.
En s’associant à des entreprises chinoises, les constructeurs européens peuvent accéder à des technologies avancées et accélérer leur transition vers des véhicules plus propres et plus connectés. Ces partenariats peuvent également leur permettre de mieux répondre aux attentes des consommateurs et de renforcer leur position sur le marché mondial.
Toutefois, pour tirer pleinement parti de ces opportunités, l’Europe devra veiller à préserver sa souveraineté technologique, à protéger ses intérêts stratégiques, et à mettre en place des politiques industrielles cohérentes et ambitieuses.
L’avenir de la coopération sino-européenne dans l’automobile électrique
Le développement de la coopération industrielle entre la Chine et l’Europe dans le secteur automobile ne peut être analysé sans intégrer les dynamiques de marché, les contraintes politiques, et les risques technologiques. Cette coopération repose sur des besoins croisés : l’Europe veut rattraper son retard technologique, tandis que la Chine doit écouler sa surproduction dans un contexte de ralentissement de la demande intérieure.
La surcapacité en Chine et ses conséquences internationales
En 2024, la Chine disposait d’une capacité de production annuelle d’environ 40 millions de véhicules, pour une demande intérieure estimée à 24 millions d’unités. Cette différence de 16 millions de véhicules représente une surcapacité structurelle de 66 %, que Pékin tente d’exporter principalement vers l’Europe, l’Amérique du Sud et l’Asie du Sud-Est.
Les conséquences de cette surcapacité sont multiples. Les prix baissent, notamment dans le segment des véhicules électriques (VE), ce qui rend l’entrée des marques chinoises particulièrement compétitive. Par exemple, la BYD Dolphin se vend à partir de 16 000 € en Chine, contre un prix moyen de 30 000 € pour un VE compact européen. Même avec des droits de douane européens de 45 %, certaines marques chinoises restent compétitives.
Cette pression tarifaire, ajoutée à l’avance chinoise en matière de batteries LFP (lithium fer phosphate) et à la maîtrise des chaînes de valeur du lithium, contraint l’Europe à réévaluer son modèle de production et ses coûts. En 2023, CATL, le plus grand fabricant de batteries au monde, contrôlait près de 37 % du marché mondial, très loin devant ses concurrents européens. Le gigafactory de CATL en Allemagne, à Erfurt, permet à la Chine de produire directement en Europe tout en y capturant la valeur ajoutée.
L’enjeu stratégique des logiciels et du véhicule défini par logiciel
La rupture technologique la plus importante réside probablement dans la conception logicielle des véhicules. Contrairement à l’approche modulaire et fragmentée historiquement adoptée en Europe, la Chine développe des véhicules dits « software-defined vehicles ». Cela signifie que les fonctions critiques – conduite autonome, gestion énergétique, connectivité – sont intégrées dès la conception dans une architecture logicielle centralisée.
Par exemple, XPeng a développé son propre système d’exploitation embarqué, capable de recevoir des mises à jour OTA (over-the-air) et d’adapter en temps réel la conduite à l’environnement. En Europe, seuls Tesla et quelques prototypes Mercedes offrent un niveau d’intégration comparable. Cette asymétrie provoque un décalage en innovation : les véhicules chinois sont pensés comme des objets technologiques mobiles, là où les marques européennes pensent encore en priorité châssis, moteur et carrosserie.
Selon McKinsey, d’ici 2030, les logiciels représenteront 15 % de la valeur totale d’un véhicule, contre moins de 5 % aujourd’hui. En valeur absolue, cela représente 2 000 à 4 000 € par véhicule, ce qui est décisif sur un segment moyen.
Face à cela, les ingénieurs européens doivent adapter leurs compétences. Le savoir-faire historique en mécanique et combustion interne doit évoluer vers une expertise en architecture logicielle, cybersécurité embarquée et développement agile, des domaines historiquement faibles dans les grands groupes européens.

Risques technologiques et dépendances croisées
Les coopérations actuelles posent aussi des risques de dépendance technologique. La crainte d’un effet miroir, où les partenaires chinois exigent à leur tour que la technologie développée avec eux reste inaccessible aux autres marchés, commence à se matérialiser. Des cas comme le retard imposé par Pékin sur l’usine BYD au Mexique, par peur de fuites technologiques vers les États-Unis, illustrent cette tension.
La réciprocité, historiquement déséquilibrée en faveur de la Chine, commence à être exigée par Bruxelles. Toutefois, il est techniquement difficile de garantir un transfert de savoir-faire sans créer une asymétrie inverse. Les partenariats doivent intégrer des clauses sur la propriété intellectuelle, la localisation du développement, et le partage du code source, des points souvent sensibles pour les deux parties.
En outre, le contenu chinois des logiciels et composants européens pourrait poser un problème réglementaire majeur si les véhicules sont destinés au marché nord-américain, notamment en vertu des lois anti-spyware et des règles commerciales imposées par le Département du Commerce américain.
La conséquence stratégique est claire : l’Europe risque de se retrouver dans une trappe technologique, incapable d’exporter vers les États-Unis tout en dépendant de la Chine pour rester compétitive sur son propre marché.
Une transition industrielle européenne encore trop lente
Le retard européen s’explique aussi par une réforme industrielle insuffisante. Entre 2021 et 2024, l’Union européenne a mis en place une réglementation stricte sur les émissions (norme Euro 7), tout en annonçant la fin de la vente des moteurs thermiques en 2035. Mais les capacités de production de VE sont restées limitées : en 2023, seulement 15 % des voitures neuves vendues dans l’UE étaient électriques, contre 31 % en Chine.
Par ailleurs, le maillage de bornes de recharge reste un frein. L’UE comptait 540 000 bornes en 2024, dont plus de 60 % concentrées aux Pays-Bas, en France et en Allemagne, avec de fortes disparités régionales. Cela rend difficile la généralisation de l’électrique, surtout dans les zones rurales. À titre de comparaison, la Chine en compte plus de 2,3 millions, avec un rythme d’installation de près de 3 000 nouvelles bornes par jour.
En termes d’investissements, la Banque européenne d’investissement a engagé environ 17 milliards d’euros dans la mobilité électrique entre 2020 et 2024. À l’échelle chinoise, ces montants sont très en dessous des niveaux d’engagement observés localement, que ce soit via le fonds souverain chinois, les prêts bancaires à taux préférentiels ou les aides locales aux start-ups.
Il reste donc à l’Europe à intégrer ses stratégies industrielles, ses politiques énergétiques, et ses investissements en infrastructures pour rattraper l’écart technologique.
LES PLUS BELLES VOITURES, votre magazine voiture en toute indépendance.